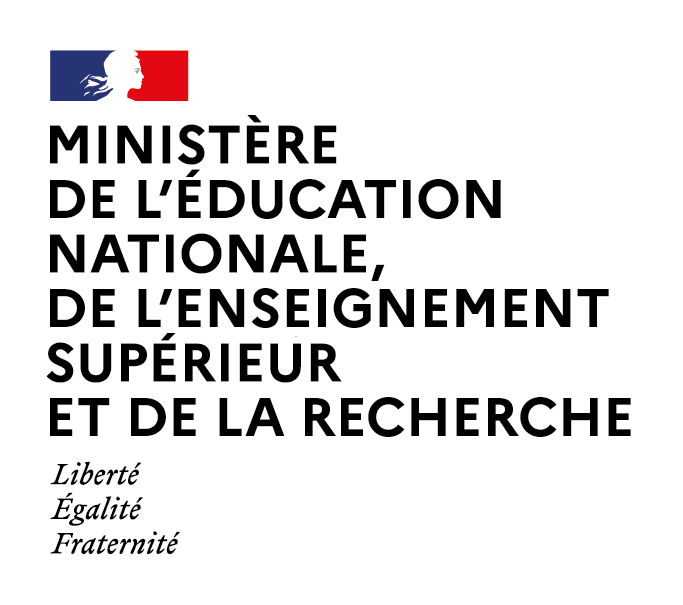
La présente note de service a pour objet d’apporter les précisions sur les modalités d’attribution du diplôme national du brevet (DNB) définies par l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié par l’arrêté du 10 avril 2025 relatif aux modalités d’attribution du DNB. Elle entre en vigueur à compter de la session 2026 du DNB.
Elle abroge la note de service n° 2017-172 du 22 décembre 2017 relative aux modalités d’attribution du DNB ainsi que la note de service du 1er avril 2025 relative à la définition des épreuves conduisant à l’obtention de la mention internationale ou franco-allemande.
Le DNB est délivré, dans la série générale et dans la série professionnelle, aux candidats ayant obtenu une moyenne finale égale ou supérieure à 10 sur 20. Pour les candidats scolaires (définis à l’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié), cette moyenne résulte d’une part, des résultats obtenus par le candidat aux épreuves terminales, qui donnent lieu à une moyenne sur 20, comptant pour 60 % du résultat final et d’autre part, de la moyenne des moyennes annuelles de l’ensemble des enseignements obligatoires suivis en classe de troisième, également exprimée sur 20, comptant pour 40 % du résultat final. Les résultats obtenus en classe de troisième dans des enseignements optionnels sont également pris en compte pour l’examen. Ce mode de calcul met fin au système antérieur de notation sur 800 points. Tous les élèves scolarisés dans un établissement scolaire sont aptes à se présenter au DNB. L’exemption ne peut être envisagée que de manière exceptionnelle.
Les autres candidats au DNB sont dits « individuels » et définis à l’article 4 de l’arrêté du 31 décembre 2015 susvisé. Pour ces candidats, le diplôme est délivré sur les notes obtenues aux épreuves terminales écrites de l’examen.
I. Organisation générale
1.1. Inscription des candidats
Les recteurs d’académie et les vice-recteurs prennent toutes les dispositions utiles concernant les modalités d’inscription des candidats au DNB.
1.1.1. Les candidats sous statut scolaire
Les élèves qui se portent candidats au DNB, sous statut scolaire (article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d’attribution du DNB) sont inscrits par les soins du chef de leur établissement, sur accord préalable de leurs représentants légaux.
Les élèves des classes de troisième se présentent en série générale.
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté précité, les élèves des classes de troisième prépa-métiers, les élèves des classes de troisième d’enseignement général et professionnel adapté (Egpa), les élèves des unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) et les élèves des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) bénéficiant de dispositifs particuliers, ont le choix de se présenter à la série générale ou à la série professionnelle du DNB.
Les candidats des classes de troisième de l’enseignement agricole se présentent à la série professionnelle.
Certains candidats, n’appartenant pas aux catégories citées supra, peuvent aussi être autorisés à se présenter à la série professionnelle : il s’agit notamment des élèves bénéficiant de l’une des modalités spécifiques d’accompagnement pédagogique définies par l’article D. 332-6 du Code de l’éducation ou des élèves en situation de handicap. Leur cas doit être soumis à l’avis du recteur d’académie ou du vice-recteur qui accorde ou non cette dérogation.
1.1.2. Les candidats individuels
Les candidats dits « individuels » (article 4 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité) suivent la procédure d’inscription au DNB mise en ligne sur la plateforme numérique académique par le rectorat d’académie de leur résidence.
Les candidats individuels choisissent la série à laquelle ils se présentent (article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité).
1.1.3. Les candidats suivant leur formation au Centre national d’enseignement à distance (Cned)
Les candidats inscrits en scolarité complète règlementée au Cned en classe de troisième ont le statut de « candidat scolaire » et sont inscrits au DNB par le Cned dans l’académie de leur résidence.
Les candidats suivant seulement une préparation au DNB dans le cadre d’une formation libre (non réglementée) ont le statut de « candidat individuel » et s’inscrivent eux-mêmes selon la procédure propre aux candidats individuels mise en ligne sur le site Internet du rectorat de leur résidence.
1.2. Déroulement de l’examen
1.2.1. Lieux de déroulement des épreuves
La liste des centres d’examen (établissements publics et privés sous contrat) est arrêtée par les recteurs d’académie et les vice-recteurs.
Sauf dérogation accordée par le recteur de l’académie ou le vice-recteur, les candidats doivent se présenter dans l’académie où ils ont accompli leur dernière année de troisième avant l’examen. Ceux qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans l’académie de leur résidence.
Les divisions des examens et concours réserveront le meilleur accueil aux demandes de transfert de certains candidats, suivant des scolarités particulières, dans des centres d’examen qui ne correspondent pas à leur lieu de scolarisation. Il s’agit :
- des candidats sportifs de haut niveau et sportifs Espoirs. S’ils doivent, au moment des épreuves, être en stage ou participer à des compétitions, il est souhaitable de leur faciliter le transfert, fût-il tardif, dans le centre d’examen le plus adéquat. Sont désignés sous l’appellation « sportifs de haut niveau » tous les bénéficiaires précisés au I de l’instruction ministérielle DS/DS2/2020/199 du 5 novembre 2020 :
- les sportifs et sportives inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
- les sportifs et sportives inscrits sur la liste des sportifs et sportives Espoirs et sur la liste des sportifs et sportives des collectifs nationaux ;
- les sportifs et sportives ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d’entraînement reconnues dans le parcours de performance fédéral (PPF) de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère chargé des sports ;
- les sportifs et sportives des centres de formation d’un club professionnel ainsi que les sportifs(ives) professionnel(le)s disposant d’un contrat de travail ;
- les juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau.
- des candidats suivant une scolarité à l’étranger ou bénéficiant d’une expérience de mobilité : s’ils sont appelés, pour des raisons diverses, à changer de résidence entre le moment de leur inscription et celui des épreuves, il est souhaitable de leur faciliter le transfert, fût-il tardif, dans le centre d’examen le plus proche de leur nouvelle résidence.
1.2.2. Surveillance des épreuves
La surveillance des épreuves est effectuée par les personnels des établissements publics et privés sous contrat, sous l’autorité du recteur d’académie ou du vice-recteur. Dans le cas où un collège privé sous contrat est centre d’examen, il est procédé à un échange partiel de ses personnels avec ceux du collège public auquel il est attaché pour le déroulement de l’examen.
Les personnels chargés de la surveillance portent une attention particulière aux modalités propres à chacune des séries et s’assurent de la conformité des sujets avec les séries, de la conformité des copies des candidats avec les préconisations précisées par les sujets.
1.2.3. Cas d’absence aux épreuves d’examen
Un candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuve(s) terminale(s) est sanctionné par la mention Absent qui se traduit par la note zéro à cette (ou ces) épreuve(s) dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Si son absence est due à un cas de force majeure, il peut, sur autorisation du recteur ou du vice-recteur, se présenter à la session de remplacement. Il doit alors passer les seules épreuves terminales (écrites ou orale) qu’il n’a pas pu présenter à la session de fin d’année scolaire et conserve la ou les notes des épreuves qu’il a pu passer.
1.2.4. Procédure en cas de fraude et conditions d’accès et de sortie des salles de l’examen
Les conditions d’accès et de sortie des salles d’examen ainsi que les mesures à prendre pour éviter les fraudes sont précisées par la circulaire n° 2011-072 du 3 mai 2011 (publiée au BO n° 21 du 26 mai 2011).
L’article 24 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité précise la procédure à suivre en cas de fraude dûment constatée. Toute fraude est à l’appréciation du jury. Elle est communiquée au président du jury qui a toute la latitude pour prononcer une sanction, notamment sur les résultats.
1.2.5. Organisation des corrections
La note de service du 12 janvier 2024 relative au déroulement des corrections aux examens du second degré à compter des épreuves 2024 précise l’organisation des corrections.
Le recteur d’académie ou le vice-recteur détermine les centres de correction et désigne les correcteurs parmi les enseignants titulaires ou contractuels des établissements publics ou privés sous contrat.
Une fois anonymisées, les copies des candidats scolarisés dans chacun de ces établissements et des candidats individuels sont corrigées.
1.3. Attribution du diplôme par le jury
La délivrance du DNB relève de la délibération du jury qui, selon les termes de l’article 17 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, est souverain en la matière.
Chaque recteur d’académie et vice-recteur établit la liste des membres du jury conformément à l’article 22 du même arrêté et détermine la compétence territoriale de celui-ci. Il désigne le président du jury. Ce jury peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements (article D. 332-19 du code de l’éducation, article 22 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité). Il se réunit au lieu fixé par le recteur d’académie. Il peut se scinder en commissions.
Il arrête, après délibération, les notes des épreuves.
Pour les candidats scolaires qui relèvent de l’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, le jury décide d’attribuer ou non le DNB au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose :
- les moyennes obtenues au cours de l’année de troisième dans l’ensemble des enseignements obligatoires, après consultation des commissions d’harmonisation ;
- le cas échéant, les points supérieurs à 10 sur 20 de la moyenne obtenue dans l’un des enseignements facultatifs ;
- les notes obtenues aux épreuves terminales écrites et orale de l’examen ;
- les synthèses des acquis scolaires de l’élève proposées dans les bilans périodiques du livret scolaire.
Pour les candidats qui relèvent de l’article 4 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, candidats dits « individuels », le jury s’appuie exclusivement sur les notes obtenues aux épreuves terminales écrites de l’examen.
1.4. Proclamation des résultats, établissement et remise du diplôme
Le recteur d’académie ou le vice-recteur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer prioritairement l’information des candidats et la publication des résultats définitifs au niveau local.
Le diplôme est établi selon les caractéristiques matérielles définies par l’arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modèles des diplômes du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien, du brevet professionnel, du brevet d’études professionnelles, du certificat d’aptitude professionnelle, de la mention complémentaire, du brevet et du certificat de formation générale.
Les services académiques veillent à ce que l’impression et la distribution des diplômes soient assurées pour la date prévue pour la cérémonie républicaine de remise du DNB en établissement. Les chefs d’établissement prennent toutes les dispositions nécessaires pour informer les diplômés de la date de remise de leur diplôme, date à laquelle ceux-ci se rendent dans l’établissement où ils étaient scolarisés.
Les recommandations relatives à l’organisation de la cérémonie républicaine de remise du diplôme sont précisées dans la note de service n° 2016-090 du 22 juin 2016 relative à l’instauration et l’organisation de la cérémonie républicaine de remise du DNB et du certificat de formation générale.
1.5. Communication des copies aux candidats
Cette communication peut se faire, après décision du jury et proclamation des résultats, dans les conditions générales définies par les textes régissant la communication des copies d’examen aux candidats (cf. note de service n° 82-028 du 15 janvier 1982 relative à la communication des copies d’examen et concours aux candidats qui en font la demande et note de service n° 85-041 du 30 janvier 1985).
1.6. Cas particuliers
1.6.1. Candidats en situation de handicap
Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, les services académiques tiennent compte des conditions particulières de participation à l’examen des candidats en situation de handicap et procèdent aux adaptations que les cas individuels rendent nécessaires, selon la réglementation en vigueur.
En cas d’adaptation du sujet ou de dispense d’un exercice prévue par la réglementation en vigueur, il est possible, sans contrevenir à l’anonymat des candidats, de mettre en place un repérage des copies ayant bénéficié de cette disposition particulière afin d’éviter des erreurs d’évaluation lors de la correction. Ce repérage peut prendre la forme d’une feuille agrafée, d’une étiquette ou de tout autre procédé qui, sans révéler l’identité ni le handicap du candidat, permet de signaler à la vigilance du correcteur une copie qui doit bénéficier d’un barème ou d’une évaluation spécifique.
L’adaptation du sujet et les aménagements d’examen sont précisés par l’arrêté du 29 mars 2018 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé et le sont aussi par la circulaire du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap.
1.6.2. Candidats allophones nouvellement arrivés en France (EANA)
L’autorisation du dictionnaire bilingue pour toutes les épreuves à l’exception de celle de la dictée est possible selon les conditions fixées par la note de service du 13 décembre 2023 relative à l’autorisation d’utiliser un dictionnaire bilingue pour certaines épreuves des examens scolaires et de certifications pour les EANA à compter de la session 2024. L’autorisation du dictionnaire induira la présence du logo sur la copie du candidat permettant une attention particulière des correcteurs des examens. Le candidat apporte un dictionnaire bilingue français/langue de scolarisation du pays d’origine ou, à défaut, français/langue vivante maîtrisée par le candidat de par son parcours scolaire antérieur (si le dictionnaire bilingue français/langue de scolarisation du pays d’origine n’existe pas).
1.6.3. Centre national d’enseignement à distance (Cned)
Le Cned procède à l’inscription à l’examen des élèves scolarisés en classe complète règlementée directement dans Cyclades et assure le transfert des moyennes au titre du contrôle continu vers Cyclades.
Les candidats du Cned relèvent du jury de l’académie dans laquelle ils ont passé les épreuves de l’examen et à qui le Cned aura transmis leur livret scolaire.
1.6.4. Sections internationales de collège – Établissements franco-allemands
L’arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d’attribution du DNB aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands précise les modalités d’attribution de la mention Option internationale ou de la mention Option franco-allemande du DNB. La présente note de service présente la définition et le déroulement des épreuves spécifiques à ces candidats.
1.6.5. Organisation de l’examen dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l’étranger
Une note de service annuelle et spécifique précise le calendrier et les modalités d’organisation des examens dont le DNB, pour les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Une note de service annuelle et spécifique précise les modalités d’organisation du DNB dans les centres ouverts à l’étranger. Les candidats de ces centres composent obligatoirement dans un établissement inscrit sur la liste des établissements d’enseignement français à l’étranger homologués pour le collège, qui est établie par arrêté publié annuellement.
1.6.6. Candidats de l’enseignement agricole
Un arrêté et une note de service du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture précisent les modalités d’attribution du DNB à ces candidats.
1.6.7. Cas des enseignements non suivis hors réglementation en vigueur
Pour les candidats scolarisés en milieu pénitentiaire, scolarisés dans les dispositifs Ulis ou UPE2A à qui n’a pas été dispensé un enseignement concerné par l’épreuve dite « de sciences », une demande de dispense peut être adressée par le chef d’établissement ou le directeur de centre pour chaque candidat selon les modalités mises en place par la division des examens et des concours de chaque académie.
1.7. Évaluation de la session d’examen
Au lendemain de l’examen, les services du rectorat font part au ministre chargé de l’éducation nationale de leurs observations et suggestions éventuelles en vue de l’amélioration du dispositif.
II. Prise en compte des acquis scolaires de la classe de troisième pour les candidats « scolaires »
L’évaluation des élèves des classes de troisième des établissements publics et privés sous contrat est menée dans le respect des dispositions du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l’évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l’école et au collège. Les connaissances et compétences qu’ils ont acquises au cours de la classe de troisième sont prises en compte dans les conditions suivantes.
2.1. Évaluation du contrôle continu
Dans le cadre des enseignements de la classe de troisième, l’évaluation du niveau des élèves, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture, est menée dans les différentes situations d’apprentissage qui sollicitent la mémorisation, l’application et le réinvestissement. Par des activités écrites ou orales, individuelles ou collectives, les professeurs évaluent en attribuant une note de 0 à 20.
Dans la perspective de l’épreuve orale prévue par l’article 7 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, une attention particulière doit être portée par l’ensemble des disciplines à l’évaluation de l’oral qui prend en compte les divers types de prise de parole des élèves.
En application des dispositions du décret précité et en conformité avec les objectifs du socle commun, le contrôle continu se fonde sur les moyennes des moyennes annuelles, issues des moyennes trimestrielles ou semestrielles de chacun des enseignements obligatoires en classe de troisième. La moyenne des moyennes annuelles représente 40 % du résultat final.
Pour le calcul de cette moyenne, à la somme des moyennes annuelles des enseignements obligatoires, peuvent s’ajouter les points supérieurs à 10 sur 20 de la moyenne obtenue dans l’un des enseignements facultatifs ou un enseignement en langue des signes française, sous réserve que la moyenne de la part de contrôle continu auxquels ces points ont été ajoutés ne dépasse pas 20 sur 20 (conformément aux dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité et à l’arrêté du 19 mai 2015 modifié relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège). Si le candidat a suivi plusieurs enseignements facultatifs, le choix de la moyenne se fait automatiquement sur la meilleure moyenne parmi les enseignements facultatifs suivis.
2.2. Harmonisation des évaluations au cours de la scolarité en classe de troisième
Au collège, pour la prise en compte des acquis de la classe de troisième, les équipes pédagogiques sous la responsabilité du chef d’établissement, veillent à la représentativité des évaluations dans le cours ordinaire des enseignements, notamment dans le cadre d’une concertation menée au sein des conseils d’enseignements et du conseil pédagogique.
La commission académique d’harmonisation du contrôle continu pourra utilement exploiter les données anonymisées à sa disposition dans chaque enseignement de manière à garantir l’égalité de traitement entre les candidats.
Présidée par le recteur d’académie ou le vice-recteur ou le représentant qu’il désigne, cette commission est mise en place dans chaque académie. Elle est composée d’inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, d’inspecteurs de l’éducation nationale et de professeurs de l’enseignement public ou privé sous contrat, nommés par le recteur d’académie ou le vice-recteur pour chaque session du brevet. Elle se réunit après les conseils de classe et avant les épreuves terminales, selon le calendrier fixé par le recteur ou vice-recteur.
Elle prend connaissance des résultats du contrôle continu présentés au brevet par les candidats et procède si nécessaire à leur harmonisation notamment en cas de discordance manifeste constatée entre la moyenne annuelle obtenue par les élèves d’un même établissement dans un enseignement et la moyenne annuelle des résultats obtenus par l’ensemble des élèves de l’académie dans ce même enseignement.
Elle pourra s’appuyer sur des éléments statistiques mis à disposition de la commission portant sur les résultats de l’établissement d’inscription des candidats au cours de deux dernières sessions à partir de la session 2028, respectant l’anonymat des candidats et de leur établissement d’inscription. Pour la session 2026, la commission disposera a minima des données de l’année en cours. Lors de la session 2027, elle disposera des données de la session précédente. Cette harmonisation peut être réalisée à la hausse comme à la baisse pour l’ensemble des moyennes annuelles d’une discipline pour les candidats issus d’un établissement donné.
Les membres de la commission peuvent participer, à l’initiative du président de la commission, aux réunions d’harmonisation par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
À l’issue de ses travaux, la commission communique les notes harmonisées au jury du brevet, lequel arrête définitivement la note finale de chaque candidat.
2.3. Établissement du livret scolaire unique (LSU) pour le diplôme national du brevet
En classe de troisième, le conseil de classe valide, pour chaque discipline, une moyenne trimestrielle ou semestrielle ainsi qu’une moyenne annuelle. Le chef d’établissement est garant de la représentativité des moyennes des élèves.
Ces moyennes validées sont renseignées dans le livret scolaire unique qui les transmet à son tour au système d’information des examens (Cyclades). La moyenne annuelle de chaque enseignement est prise en compte pour l’obtention du DNB en l’arrondissant au centième de point supérieur.
2.4. Cas particuliers
2.4.1. Résultats des élèves venant d’un établissement d’enseignement privé hors contrat
Dans le cas d’un candidat venant d’un établissement privé hors contrat et scolarisé au cours de l’année de la classe de troisième dans un établissement public ou dans un établissement privé sous contrat, seules sont prises en compte les notes obtenues à compter de la date d’arrivée de l’élève dans ce dernier établissement, dans l’ensemble des enseignements, en vue de l’attribution du DNB.
2.4.2. Cas des absences ponctuelles d’évaluation
2.4.2.1. Cas des élèves scolarisés en établissements scolaires
Pour être réellement représentative du niveau d’un élève, la moyenne doit nécessairement être construite à partir d’une pluralité de notes. Le contrôle continu implique un respect scrupuleux de l’obligation d’assiduité prévue par l’article L. 511-1 du Code de l’éducation, qui impose aux élèves de suivre l’intégralité des enseignements obligatoires et facultatifs auxquels ils sont inscrits. À ce titre, les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités du contrôle continu qui leur sont imposées. Ils sont tenus de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans leur emploi du temps établi par l’établissement scolaire.
Un suivi attentif de l’assiduité des élèves est mis en place dans chaque établissement accueillant des candidats scolaires afin d’anticiper les difficultés éventuelles de constitution de moyennes.
Lorsque l’absence répétée d’un élève aux évaluations est jugée par son professeur comme faisant peser un risque sur la représentativité de sa moyenne, une nouvelle évaluation est spécifiquement organisée à son intention. Dans l’hypothèse où une moyenne périodique n’est pas jugée « représentative », celle-ci peut être remplacée par la mention En attente sur le bilan périodique de l’élève.
En fin d’année scolaire, le conseil de classe statue sur la situation des élèves dont une ou plusieurs moyennes périodiques ont été remplacées par la mention En attente. L’objectif est de faire en sorte que tous les élèves aient une moyenne annuelle sur 20 dans toutes les matières et de s’assurer avec discernement du caractère représentatif de ces moyennes. À cette fin, il peut être fait recours à une évaluation de remplacement qui permettra de rendre compte du niveau des acquis de l’élève. La note obtenue par l’élève à cette évaluation de remplacement est retenue en lieu et place de la moyenne annuelle manquante. Dans le cas d’une absence dûment justifiée à cette évaluation, l’élève est à nouveau convoqué. Si l’absence n’est pas dûment justifiée, la note zéro est attribuée pour cet enseignement.
Seules les dispenses règlementaires relatives à l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS) et à la deuxième langue vivante sont autorisées. Elles seront renseignées avec la mention Dispensé dans le LSU.
2.4.2.2. Cas des élèves scolarisés au Cned
En l’absence d’évaluations suffisantes réalisées par l’élève en cours d’année scolaire, le Cned organise une évaluation de remplacement, permettant de rendre compte du niveau des acquis de l’élève. La note obtenue par l’élève à cette évaluation de remplacement est retenue en lieu et place de la moyenne annuelle. En cas d’absence à l’évaluation de remplacement, la note de 0 sera attribuée à l’élève.
Le dernier conseil de classe valide l’ensemble des moyennes annuelles disciplinaires.
2.4.3. Cas de l’évaluation de l’EPS pour les élèves scolarisés au Cned
Les élèves en scolarité réglementée au Cned sont dispensés de l’évaluation en EPS au titre du contrôle continu.
III. Définition des épreuves de l’examen
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d’attribution du DNB, les épreuves terminales de l’examen sont prises en compte à hauteur de 60 %, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves. Les sujets et les modalités de ces épreuves correspondent aux programmes du cycle 4 jusqu’à la session 2026. À partir de la session 2027, les sujets des épreuves écrites porteront sur les programmes de la classe de troisième.
Le tableau ci-dessous récapitule la liste des épreuves terminales ainsi que les coefficients affectés :
| Candidats scolaires | Candidats individuels | |
| Contrôle continu | 40 % de la note globale**sont ajoutés au total des moyennes du contrôle continu, les points supérieurs à 10 sur 20 de la moyenne obtenue dans l’un des enseignements facultatifs ou dans l’enseignement en langue des signes française suivi par le candidat, sous réserve que la moyenne de la part de contrôle continu auxquels ces points s’ajoutent ne dépasse pas 20 sur 20. | |
| Épreuves terminales notées sur 20 : | 60 % de la note globale | 100 % de la note globale |
| Français | Coefficient 2 | Coefficient 2 |
| Mathématiques | Coefficient 2 | Coefficient 2 |
| Histoire-géographie Enseignement moral et civique | Coefficient 1,5Coefficient 0,5 | Coefficient 1,5Coefficient 0,5 |
| Sciences | Coefficient 2 | Coefficient 2 |
| Oral de soutenance | Coefficient 2 | |
| Langue vivante étrangère | Coefficient 2 | |
| Épreuves conduisant à l’obtention de la mention Internationale ou Franco-allemande**La mention Internationale ou mention Franco-allemande est attribuée aux candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 pour chacune des deux épreuves. Ces épreuves sont prises en compte dans le calcul de la moyenne des épreuves terminales. | ||
| Oral dans la langue de la section ou allemand pour les établissements franco-allemands | Coefficient 1 | |
| Oral dans la discipline non-linguistique | Coefficient 1 | |
Pour les candidats de la série professionnelle, des sujets distincts sont élaborés pour chacune des quatre épreuves écrites, en adéquation avec les spécificités des classes de troisième prépa-métiers, des classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l’enseignement agricole.
Ces spécificités sont explicitées dans des référentiels adaptés établis sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour l’enseignement agricole, du ministre chargé de l’agriculture.
3.1. Épreuves écrites communes à l’ensemble des candidats
3.1.1. Épreuve écrite de français : (coefficient 2)
Durée de l’épreuve : 3 heures
Objectifs de l’épreuve : l’épreuve de français a pour but d’évaluer les connaissances et compétences déclinées par le programme de français de cycle 4 (ou de troisième à partir de la session 2027), à savoir « lire », « écrire », « comprendre le fonctionnement de la langue » et avoir acquis « des éléments de culture littéraire et artistique ».
Évaluation et composition de l’épreuve : l’épreuve est notée sur 20. Les exercices sont assortis d’un barème totalisant 100 points, indiqué dans le sujet. La note obtenue est ensuite ramenée sur 20 pour le calcul de la moyenne.
L’épreuve prend appui sur un corpus de français, composé d’un texte littéraire et éventuellement d’une image en rapport avec le texte. La maîtrise de la langue française à l’écrit est évaluée dans l’ensemble des exercices composant l’épreuve.
Travail sur le texte littéraire et, éventuellement, sur une image (50 points – 1 heure et 10 minutes)
Grammaire et compétences linguistiques
Des questions sur le texte permettent d’évaluer les compétences linguistiques du candidat et sa maîtrise de la grammaire. Il s’agit d’apprécier la capacité des élèves à comprendre et analyser le fonctionnement de la langue et son organisation. Les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique, morphologique, lexical de la langue, les différences entre l’oral et l’écrit peuvent faire l’objet de questions.
Dans ce cadre, un exercice de réécriture propose aux élèves un court fragment de texte dont il s’agit de transformer les temps et/ou l’énonciation et/ou les personnes et/ou les genres, etc. de manière à obtenir cinq ou dix formes modifiées dans la copie de l’élève. Les erreurs de pure copie ne portant pas sur les formes à modifier sont prises en compte dans l’évaluation selon un barème spécifique.
Compréhension et compétences d’interprétation
Le travail sur le texte littéraire permet à la fois d’évaluer la compréhension du texte et les compétences d’interprétation des candidats. Différentes questions portent sur l’analyse de faits de langue et d’effets stylistiques dont l’élucidation permet d’approfondir la compréhension et l’interprétation du texte. Certaines questions engagent le candidat à formuler ses impressions de lecture et à donner son sentiment sur le texte proposé en justifiant son point de vue de manière construite et développée. Des questions exigent du candidat des développements construits. L’une d’entre elles au moins permet au candidat de développer une appréciation personnelle. D’autres, plus ponctuelles, appellent des réponses plus courtes.
L’énoncé précise aux candidats lorsqu’une réponse construite et développée est attendue ou lorsqu’il s’agit d’une réponse courte. Les qualités rédactionnelles sont valorisées par le barème de notation.
Le questionnaire, qui vise à évaluer l’autonomie du candidat, ne comporte pas d’axes de lecture.
Une ou deux questions portant sur l’image, si le sujet en comporte une, permettent au candidat de faire valoir des compétences d’analyse spécifiques et de mettre cette image en relation avec le texte littéraire.
Dictée (10 points – 20 minutes)
Un texte de 600 signes environ, en lien avec l’œuvre, est dicté aux candidats de la série générale.
Pour les candidats de série professionnelle, le texte dicté est de 400 signes environ.
Rédaction (40 points – 1 heure et 30 minutes)
Deux sujets au choix sont proposés aux candidats : un sujet de réflexion et un sujet d’imagination.
Le candidat doit rédiger un texte cohérent et construit, respectant les normes de la langue écrite.
Outre la qualité de l’expression écrite et de l’orthographe, appréciée dans la grille de correction, il est tenu compte, dans l’évaluation du travail produit, de la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances et compétences de manière à répondre aux contraintes du sujet choisi. L’énoncé indique le nombre minimal de lignes attendu.
Les candidats ont le droit, pour cette partie d’épreuve, de consulter un dictionnaire de langue française ou un dictionnaire bilingue. Chacun doit apporter le dictionnaire qu’il souhaite pouvoir consulter.
3.1.2. Épreuve écrite de mathématiques (coefficient 2)
Durée de l’épreuve : 2 heures
Objectifs de l’épreuve : pour tous les candidats, l’épreuve évalue les connaissances et compétences attendues en fin de cycle 4 et déclinées par le programme de mathématiques de cycle 4 (sur le programme de la classe de troisième à partir de la session 2027). À travers les exercices proposés, les candidats sont amenés à mobiliser les compétences chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer et communiquer. Le brouillon est autorisé sur l’ensemble de l’épreuve.
Le sujet est constitué d’exercices qui doivent pouvoir être traités par le candidat indépendamment les uns des autres. L’épreuve est notée sur 20. Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet. La calculatrice n’est autorisée que sur la partie 2.
Partie 1 – Automatismes : 6 points – 20 minutes
Les élèves réalisent cette partie sans calculatrice. Elle évalue la maîtrise des automatismes au cycle 4.
Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes :14 points – 1 heure et 40 minutes.
Certains exercices peuvent inclure des situations issues de la vie courante ou d’autres disciplines. Ils peuvent adopter toutes les modalités possibles.
L’évaluation doit prendre en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité de la rédaction qui sera évaluée sur 2 points. Doivent être pris en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. Le sujet précise que toutes les réponses doivent être justifiées sauf si une indication contraire est donnée.
3.1.3. Épreuve écrite d’histoire-géographie-enseignement moral et civique (coefficient 2)
Durée de l’épreuve : 2 heures
Objectifs de l’épreuve : l’épreuve d’histoire et géographie, et d’enseignement moral et civique a pour but d’évaluer les connaissances et compétences attendues par les programmes de cycle 4 (ou par la classe de troisième à partir de la session 2027) respectivement pour chacune de ces disciplines et fondées plus particulièrement sur les contenus définispar les repères annuels. (Pour la série générale, on se reporte aux repères figurant dans les ressources d’accompagnement publiées par la direction générale de l’enseignement scolaire, pour la série professionnelle au référentiel du Bulletin officiel n° 37 du 13 octobre 2016).
Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, les exercices portant sur le programme d’histoire et géographie et sur le programme d’enseignement moral et civique ouvrent la possibilité, pour les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale, de composer en français ou en langue régionale.
Le candidat traite les exercices de chacune des deux sous-épreuves sur les deux heures sans pause entre les deux.
L’épreuve est notée sur 40. La note obtenue est ensuite ramenée sur 20 pour le calcul de la moyenne.
Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.
Sous-épreuve histoire-géographie : coefficient 1,5
Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie (15 points)
Ces exercices s’appuient sur un ou deux documents qui relèvent du programme d’histoire et géographie. Ces documents sont remis au candidat avec le sujet. Un document iconographique peut y être adjoint.
Les exercices visent à évaluer la capacité du candidat à analyser et comprendre ces documents en utilisant les raisonnements et les méthodes de l’histoire et de la géographie, à maîtriser des connaissances fondamentales et à mobiliser les repères chronologiques et spatiaux contenus dans les programmes d’histoire et de géographie. Les questions ou consignes proposées ont pour objectif de guider le candidat pour vérifier sa capacité à identifier ces documents, à en dégager le sens, à en prélever des informations, et, le cas échéant, à porter sur ces documents un regard critique en indiquant leur intérêt ou leurs limites. L’énoncé précise aux candidats lorsqu’il s’agit d’une réponse courte ou lorsqu’une réponse doit être davantage construite et développée en précisant un nombre indicatif de lignes. La qualité de la rédaction est prise en compte et valorisée dans le barème.
Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques (25 points)
Un développement construit, d’au moins 30 lignes pour les candidats de la série générale et d’au moins 20 lignes pour la série professionnelle, sous la forme d’un texte structuré et de longueur adaptée à un élève en fin de cycle 4, répond à une question d’histoire ou de géographie. La qualité de la rédaction est prise en compte et valorisée dans le barème (18 points).
Une question invite le candidat à rendre compte de la compréhension et du traitement de données par le biais de croquis, de schémas ou de frises chronologiques. (7 points)
Sous-épreuve enseignement moral et civique : coefficient 0,5
Objectifs : mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral et civique. Une problématique d’enseignement moral et civique est posée à partir d’une situation pratique appuyée sur un ou deux documents. Le questionnaire qui amène le candidat à y répondre comprend des questions à réponse courte (comme des questionnaires à choix multiples, des tableaux à compléter, des questions simples) et une réponse plus développée. L’énoncé précise aux candidats lorsqu’il s’agit d’une réponse courte ou lorsqu’une réponse construite et développée est attendue, en précisant un nombre indicatif de lignes. La qualité de la rédaction est prise en compte et valorisée dans le barème.
3.1.4. Épreuve écrite de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie, dite « épreuve de sciences » (coefficient 2)
Durée de l’épreuve : deux fois trente minutes (temps indicatif), soit 1 heure
Objectifs de l’épreuve : pour tous les candidats, l’épreuve évalue principalement les connaissances et compétences définies par les programmes de cycle 4 (de la classe de troisième à partir de la session 2027) respectivement pour chacune des trois disciplines – physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.
Pour cette épreuve, à chaque session de l’examen, deux disciplines seulement sur les trois citées – physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie – sont retenues.
Le choix des deux disciplines est signifié deux mois avant la date de l’examen. Ce choix est valable pour la session normale (en fin d’année scolaire) et la session de remplacement (en septembre). Il peut être différent pour les sessions des centres étrangers.
Le candidat traite les exercices de chacune des deux disciplines retenues sur une seule et même copie.
Composition de l’épreuve :
Le sujet est constitué d’exercices qui doivent pouvoir être traités par le candidat indépendamment les uns des autres.
Certains exercices exigent de la part du candidat une prise d’initiative dans le cadre d’une question ouverte où les élèves exercent leur capacité à chercher et à raisonner. L’énoncé précise au candidat le caractère développé et construit de la réponse avec un nombre indicatif de lignes. La qualité de la rédaction est prise en compte et valorisée dans le barème.
Les exercices peuvent prendre appui sur des situations issues de la vie courante ou d’autres disciplines. Ils peuvent adopter toutes les modalités possibles, y compris la forme de questionnaires à choix multiples.
Le sujet de l’épreuve est construit afin d’évaluer l’aptitude du candidat :
- à maîtriser les compétences et connaissances prévues par les programmes ;
- à exploiter des données chiffrées et/ou expérimentales ;
- à analyser et comprendre des informations en utilisant les raisonnements, les méthodes et les modèles propres aux disciplines concernées.
Évaluation de l’épreuve : l’évaluation doit prendre en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, la qualité de la rédaction scientifique. Les solutions exactes et la mise en œuvre d’idées pertinentes clairement formulées doivent être pleinement valorisées lors de la correction. Doivent aussi être pris en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. Les candidats en sont informés par l’énoncé.
L’ensemble de cette épreuve intitulée Épreuve de sciences est noté sur 20, 10 points pour chacune des disciplines. Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.
3.2. Épreuve orale pour les candidats scolaires : soutenance (coefficient 2)
Seuls les candidats scolaires (mentionnés à l’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d’attribution du DNB) sont concernés par cette épreuve orale.
Durée de l’épreuve : 15 minutes.
L’épreuve orale de soutenance d’un projet permet au candidat de présenter l’un des objets d’étude qu’il a abordés dans le cadre de l’enseignement d’histoire des arts, ou l’un des projets qu’il a menés au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l’un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours éducatif de santé, parcours d’éducation artistique et culturelle) qu’il a suivis.
Cette épreuve orale est une soutenance. Elle a pour objet d’évaluer les compétences d’expression à l’oral du candidat ainsi que sa capacité à rendre compte des compétences et connaissances qu’il a acquises dans le cadre des programmes d’enseignement de l’histoire des arts et de toutes les disciplines qui ont contribué à nourrir cette soutenance. Elle évalue sa capacité à rendre compte de son engagement dans les projets sur lesquels la soutenance repose, et notamment de ses expériences dans le cadre des rencontres et des actions qui ont motivé ou soutenu cet engagement.
Les candidats peuvent choisir de présenter l’épreuve individuellement ou en groupe, sans qu’un groupe puisse excéder trois candidats. Dans tous les cas, chaque candidat fait l’objet d’une évaluation et d’une notation individuelles.
Les candidats scolarisés au Cned présentent l’épreuve individuellement uniquement.
Le candidat peut, le cas échéant, présenter ce qu’il a réalisé (production sous forme de projection, enregistrement, réalisation numérique, etc.). Cette réalisation concrète ne peut intervenir qu’en appui d’un exposé qui permet d’évaluer essentiellement sa maîtrise de l’expression orale et du sujet. Elle ne peut donc se substituer à la présentation synthétique qu’elle peut cependant illustrer.
Le candidat peut effectuer une partie de sa présentation en langue vivante étrangère ou régionale, dans la mesure où cette langue est enseignée dans l’établissement. Cette présentation en langue étrangère ou régionale, qu’elle soit faite pendant l’exposé ou pendant l’entretien, ne doit pas excéder cinq minutes au total.
Si le candidat a connu une expérience de mobilité internationale, il est recommandé qu’il puisse la valoriser dans son exposé.
3.2.1. Structure de l’épreuve
L’oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d’un entretien avec le jury.
Dans le cas d’une épreuve individuelle, l’oral prend la forme d’un exposé par le candidat d’environ cinq minutes suivi d’un entretien d’une dizaine de minutes avec le jury. Le cas échéant, le candidat peut être guidé par le jury pour mener à bien son exposé personnel. La durée totale de l’épreuve ne peut dépasser quinze minutes.
Si l’épreuve est collective, chacun des candidats intervient pendant les dix minutes de l’épreuve. Lors de l’entretien avec le jury qui dure quinze minutes, l’ensemble des candidats est sollicité. Le jury veille à ce que chaque candidat dispose d’un temps de parole suffisant pour exposer son implication personnelle dans le sujet ou le projet présenté.
3.2.2. Modalités de l’épreuve
Localisation de l’épreuve, période de passation et convocation des candidats
Après avis du conseil pédagogique, le chef d’établissement fixe les modalités de passation de l’épreuve, notamment les dates auxquelles aura lieu l’épreuve orale pour les candidats scolaires. Le chef d’établissement informe le conseil d’administration de ces modalités.
L’épreuve orale a lieu dans l’établissement dans lequel l’élève a accompli sa scolarité ou, pour les candidats du Cned, dans l’établissement où ils sont convoqués pour les épreuves écrites. L’épreuve est située durant une période comprise entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves écrites de l’examen, dont les dates sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les établissements de l’hémisphère Sud fixent le calendrier sur la même temporalité en tenant compte de leur rythme. Le chef d’établissement établit pour chaque candidat une convocation individuelle à l’épreuve.
Choix du sujet ou du projet présenté
Le choix du sujet ou du projet que le candidat souhaite présenter durant l’épreuve orale est transmis au chef d’établissement par les responsables légaux de l’élève, selon les modalités fixées par le conseil d’administration. Ce choix précise l’intitulé et le contenu du sujet ou du projet présenté. Il mentionne aussi les disciplines d’enseignement impliquées. Le candidat fait également savoir s’il souhaite présenter son exposé en équipe (auquel cas les noms des autres candidats sont mentionnés) ou s’il souhaite effectuer une partie de sa présentation dans une langue vivante étrangère ou régionale qui est alors précisée.
Pour les élèves scolarisés au Cned, le choix du sujet est transmis au chef d’établissement dans lequel l’élève est convoqué pour l’épreuve par les représentants légaux de l’élève.
Le jury de l’épreuve orale
Le chef d’établissement établit la composition des jurys. Il tient compte, pour ce faire, des sujets présentés. L’établissement suscite autant que possible la représentation de toutes les disciplines dans les jurys. Chaque jury est constitué d’au moins deux professeurs qui peuvent être ou non en charge de la classe à laquelle appartient le candidat. Pour les candidats qui souhaitent effectuer une partie de leur prestation dans une langue vivante étrangère ou régionale, le chef d’établissement s’assure de la participation au jury d’un enseignant de la langue concernée.
Au moins dix jours ouvrés avant l’épreuve orale, le chef d’établissement transmet aux membres du jury, une liste des candidats avec la date et l’horaire de leur épreuve. Cette liste précise aussi, pour chaque candidat évalué, l’intitulé et le contenu du sujet présenté. Elle mentionne aussi les disciplines d’enseignement impliquées. La liste précise aussi, lorsque tel est le cas, le nom de tous les candidats qui se présentent conjointement ainsi que la langue retenue dans le cas d’un exposé intégrant l’usage d’une langue vivante étrangère ou régionale.
Dans le cas d’une prestation en langue étrangère ou régionale, qu’elle soit faite pendant l’exposé ou pendant l’entretien, celle-ci ne doit pas excéder cinq minutes au total. Dans son évaluation, le jury valorise cette prestation, dès lors qu’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue concernée est atteint par le candidat.
Les examinateurs s’assurent que leurs questions restent dans les limites de ce qui est exigible d’un élève de classe de troisième.
Cas particuliers
Dans le cas d’élèves en situation de handicap, on veillera à adapter le choix du sujet présenté en fonction de leur situation. Un aménagement d’épreuve est à envisager si nécessaire.
Si un candidat ne se présente pas, pour un motif dûment justifié, à l’épreuve orale à la date de sa convocation, le chef d’établissement lui adresse une nouvelle convocation, à une date qui doit être, en tout état de cause, fixée au plus tard le dernier jour des épreuves écrites de la session de juin. Si cette nouvelle convocation n’est pas honorée, le candidat n’obtient aucun point à l’épreuve orale, sauf s’il est autorisé à se présenter à la session de remplacement, du fait d’une absence pour un motif dûment justifié.
Un candidat qui s’est présenté à l’épreuve orale, mais qui, pour un motif dûment justifié, est absent aux épreuves écrites de la session normale, garde le bénéfice de la note d’épreuve orale qu’il a obtenue et passe les épreuves écrites de la session de remplacement.
Les candidats inscrits en scolarité complète réglementée au centre national d’enseignement à distance (Cned) présentent l’épreuve orale conformément aux dispositions communes. Cependant, dans certains cas de force majeure, dûment constatée par le recteur de l’académie dans laquelle le candidat est inscrit, cette épreuve peut prendre la forme d’un dossier évalué par leurs enseignants dans le cadre du suivi de leurs acquis scolaires. Les mêmes dispositions sont accordées aux candidats bénéficiant d’une expérience de mobilité qui les empêche de se présenter dans leur établissement d’origine.
Évaluation de l’épreuve
L’évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, tant du point de vue des contenus que de son expression. Il est à noter que l’évaluation de la maîtrise de l’oral est un objectif transversal et partagé qui peut être évalué par tout enseignant de toute discipline.
Les examinateurs veillent à élargir leur questionnement, au-delà des acquis disciplinaires, à la dimension interdisciplinaire et culturelle de l’objet d’étude ou du projet que le candidat présente. Afin de valoriser l’investissement de l’élève dans le travail fourni, les examinateurs peuvent élargir leur interrogation à d’autres projets ou sujets ayant été réalisés ou abordés au cours du cycle par le candidat.
L’épreuve est notée sur 20 :
- maîtrise de l’expression orale : 8 points ;
- maîtrise du sujet présenté : 12 points.
Comme toute note d’examen, la note obtenue à cette épreuve orale ne doit pas être communiquée aux candidats avant la publication officielle des résultats du DNB.
Grille indicative de critères d’évaluation de l’épreuve orale de soutenance :
Tout ou partie des critères présentés ici peuvent servir aux établissements pour définir leur propre grille d’évaluation de l’épreuve orale.
- Maîtrise de l’expression orale :
- s’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire ;
- formuler un avis personnel à propos d’une œuvre ou d’une situation en visant à faire partager son point de vue ;
- exposer les connaissances et les compétences acquises en employant un vocabulaire précis et étendu ;
- participer de façon constructive à des échanges oraux ;
- participer à un débat, exprimer une analyse argumentée et prendre en compte son interlocuteur ;
- percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de la parole ;
- s’approprier et utiliser un lexique spécifique au contexte, à savoir, le cas échéant :
- utiliser la langue française avec précision du vocabulaire et correction de la syntaxe pour rendre compte des observations, expériences, hypothèses et conclusions ;
- passer d’un langage scientifique à un autre ;
- décrire, en utilisant les outils et langages adaptés, la structure et le comportement des objets ;
- expliquer à l’oral (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de construction géométrique, un algorithme), comprendre les explications d’un autre et argumenter dans l’échange ;
- exprimer son émotion face à une œuvre d’art ;
- décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple et adapté ;
- mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, grammaticales et culturelles pour présenter à l’oral des sujets variés en langue étrangère ou régionale ;
- développer des stratégies pour surmonter un manque lexical lors d’une prise de parole, s’autocorriger et reformuler pour se faire comprendre.
- Maîtrise du sujet présenté :
- concevoir, créer, réaliser ;
- mettre en œuvre un projet ;
- analyser sa pratique, celle de ses pairs ;
- porter un regard critique sur sa production individuelle ;
- argumenter une critique adossée à une analyse objective ;
- construire un exposé de quelques minutes en mentionnant les connaissances et les compétences acquises ;
- raisonner, justifier une démarche et les choix effectués ;
- mobiliser des outils numériques.
3.3. Épreuve écrite de langue vivante étrangère des candidats individuels (coefficient 2)
L’épreuve de langue vivante étrangère ne concerne que les candidats dits « individuels », c’est-à-dire ceux mentionnés à l’article 4 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d’attribution du DNB. Le choix de la langue vivante est effectué par le candidat au moment de son inscription, au sein de la liste établie par le ministre chargé de l’éducation nationale, dans la mesure où cette langue fait partie de celles pour lesquelles le recteur de l’académie où s’inscrit le candidat a ouvert cette possibilité.
Nature de l’épreuve : écrite
Durée de l’épreuve : 1 heure 30
Objectifs : l’épreuve vise à évaluer les différentes capacités langagières liées à l’écrit, dans l’ordre suivant :
- première partie : évaluation de la compréhension d’un texte écrit ;
- deuxième partie : évaluation de l’expression écrite.
Première partie : un texte écrit de deux cents mots maximum est proposé aux candidats. Il est choisi pour permettre l’évaluation de la compréhension au niveau attendu en fin de troisième dans les programmes en vigueur. Son contenu est en relation avec les thématiques culturelles définies par les programmes et ancrées dans l’aire linguistique du ou des pays concernés. Un certain nombre d’exercices, en langue étrangère ou en français, vérifie la compréhension globale et détaillée du texte.
Deuxième partie : les candidats rédigent un texte d’une longueur de 50 à 80 mots environ. Le sujet qui leur est proposé est en relation avec la thématique culturelle du texte choisi pour la partie Compréhension.
En tout état de cause, les sujets sont élaborés dans le respect strict des instructions ministérielles propres à chaque langue vivante.
L’épreuve est évaluée sur 20 points répartis comme suit :
- première partie : 10 points ;
- deuxième partie : 10 points.
3.4. Épreuves orales conduisant à l’obtention de la mention Internationale ou Franco-allemande
Conformément à l’arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d’attribution du DNB aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands, deux épreuves orales spécifiques sont organisées. L’organisation générale de ces épreuves est placée sous l’autorité du recteur d’académie ou, à l’étranger, du chef de poste diplomatique.
Au niveau local, chaque établissement détermine le calendrier de passation des épreuves spécifiques en s’efforçant de retenir la période faisant suite au conseil de classe du troisième trimestre des classes de troisième. Les épreuves sont organisées sous l’autorité du chef d’établissement qui établit la liste des membres du jury et les convocations individuelles des candidats.
Dans la mesure où ces épreuves orales font partie des épreuves terminales de l’examen, les notes obtenues ne doivent pas être communiquées aux candidats avant la publication officielle des résultats du DNB.
3.4.1. Épreuve orale de langue de la section internationale ou de langue allemande dans les établissements franco-allemands (coefficient 1)
L’épreuve orale de langue de la section internationale ou de langue allemande dans les établissements franco-allemands prend appui sur un dossier portant sur une ou deux thématiques, prioritairement littéraires. Celui-ci est composé par le candidat sous la conduite et avec l’aide de son professeur. Il comporte des documents laissés à l’initiative du candidat (principalement des textes littéraires – poèmes ou extraits de poème, extraits de roman, de nouvelle, de pièce de théâtre, mais aussi des textes documentaires, des reproductions d’œuvres d’art, des affiches, des supports publicitaires, des textes de chanson, des contenus multimédias, etc.). Ces documents peuvent prendre une forme numérique. En outre, le dossier contient au moins une production écrite qui s’inscrit dans le ou les thèmes retenus. Celle-ci a été conçue, élaborée et rédigée par le candidat dans la langue de la section internationale ou en allemand dans le cadre de l’enseignement linguistique.
Le temps affecté à cette épreuve est de vingt minutes.
Pendant les dix premières minutes de l’épreuve, le candidat présente son dossier : il justifie sa sélection de textes et documents, explique sa démarche, expose son appréciation et son jugement personnels sur tel ou tel aspect ou élément du dossier. Il explique les choix qui ont guidé sa production écrite et la place qu’il lui a donnée dans le dossier. Même si ce(s) texte(s) écrit(s) par le candidat peut(vent) faire l’objet d’un échange avec l’examinateur, il(s) ne donne(nt) pas lieu à une évaluation spécifique dans le cadre de l’épreuve.
Dans l’entretien d’une durée de dix minutes qui suit cette présentation, l’examinateur invite le candidat à développer ou préciser tel ou tel point de son exposé. Il peut lui demander de concentrer plus particulièrement ses commentaires sur l’un des documents qu’il a fait figurer dans son dossier ou sur sa production écrite. Il peut aussi inciter le candidat à élargir ses propos à d’autres thèmes étudiés pendant l’année scolaire.
La présentation du dossier et l’entretien avec l'(ou les) examinateur(s) constituent les éléments d’appréciation de la capacité linguistique du candidat. Les compétences langagières sont évaluées en référence au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
3.4.2. Épreuve orale portant sur la discipline non linguistique
Conduite, de manière libre, dans la langue de la section internationale ou dans la langue allemande, cette épreuve prend pour support les travaux, les activités, les études de documents qui ont été effectués dans le cadre de la discipline non linguistique dans l’année scolaire écoulée, à partir des contenus des programmes traités dans la langue de la section. Ils sont présentés à l'(ou aux) examinateur(s) sous la forme d’une liste validée par le chef d’établissement.
Le candidat est invité à présenter un commentaire répondant à un sujet proposé par l'(ou les) examinateur(s) en relation avec les thématiques étudiées pendant l’année scolaire.
Les éléments constitutifs de l’évaluation de cette discipline sont :
- les compétences et connaissances dont le candidat aura fait preuve dans la discipline non linguistique et notamment dans ce qui lie cette discipline à l’identité culturelle du pays partenaire de la section ;
- l’ouverture qu’il aura manifestée sur l’environnement du pays.
La capacité du candidat à présenter un exposé structuré et à argumenter ainsi que sa maîtrise de l’expression orale sont également prises en compte.
Le temps affecté à cette épreuve est de trente minutes. Il se décompose ainsi : quinze minutes sont consacrées par le candidat à la préparation de sa prestation. Celle-ci donne lieu à dix minutes de présentation suivie par un entretien de cinq minutes avec l'(ou les) examinateur(s).
IV. Instructions relatives à l’élaboration des sujets
4.1. Sujets des épreuves
Les sujets sont élaborés conformément aux définitions d’épreuves ci-après.
Chaque épreuve comporte, en tant que de besoin, des sujets principaux et des sujets de secours pour les sessions normales et de remplacement pour les académies métropolitaines et d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et l’étranger, selon les indications fournies par la Mission du pilotage des examens (MPE).
Il est fait mention sur chaque sujet des documents ou matériels autorisés ou interdits (dictionnaire éventuellement bilingue, calculatrice, etc.), ainsi que des changements de copies que doit effectuer chaque candidat pour telle épreuve ou partie d’épreuve.
4.2. Choix des sujets
4.2.1. Les commissions d’élaboration des sujets
Après consultation de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR), le ministre peut déléguer à des recteurs d’académie ou vice-recteur le soin d’arrêter la composition des commissions d’élaboration des sujets et la responsabilité du choix des sujets. Chaque recteur d’académie décide du nombre de commissions à constituer en fonction du nombre de sujets que la direction générale de l’enseignement scolaire l’a chargé d’élaborer. Le nombre des membres de chaque commission d’élaboration ou de choix des sujets doit rester inférieur ou égal à dix.
Le mode de fonctionnement de chaque commission est laissé à l’appréciation du recteur d’académie ou du vice-recteur ; il veille, en tout état de cause, à privilégier les modalités d’organisation des commissions qui se révèlent les plus sûres et les mieux adaptées tout en garantissant leur bon fonctionnement.
Les commissions sont composées de représentants de l’IGÉSR, qui garantissent la validité des sujets (programmes et format de l’épreuve) et la pertinence des éléments de correction, de membres des corps d’inspection à compétence pédagogique et d’enseignants de l’éducation nationale et, pour l’épreuve de sciences de la série professionnelle option agricole, de membres des corps d’inspection de l’enseignement agricole. Les enseignants sont choisis de manière à représenter la diversité des établissements, des types d’enseignement et des publics scolaires.
Les commissions veillent à ce que les sujets soient en conformité avec les programmes, les objectifs et les définitions des épreuves. Elles veillent notamment à l’équilibre des questions qui doivent permettre aux élèves de faire preuve d’un niveau de maîtrise satisfaisant au regard des attentes des programmes en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Elles s’assurent également que les candidats sont en mesure de traiter les réponses dans le cadre de la durée impartie.
Les commissions établissent, pour chaque sujet, des barèmes de correction chiffrés ainsi que des recommandations de correction détaillées. Toutes indications quant au niveau des compétences et des connaissances attendues des candidats doivent être clairement définies. L’ensemble de ces éléments doit être communiqué aux correcteurs avant la correction des copies dans le cadre de la commission d’entente.
4.2.2. Essai et contrôle des sujets
Chaque proposition de sujet est testée par un (ou deux) professeur(s) enseignant dans les classes concernées et ne faisant pas partie de la commission. Ce(s) professeur(s) doi(ven)t apporter une réponse détaillée dans la moitié du temps accordé aux élèves. Il(s) rédige(nt) par ailleurs un rapport sur le sujet. Ce rapport examine notamment les erreurs ou ambiguïtés éventuelles que le sujet comporte, la qualité des supports et documents choisis ainsi que la pertinence de sa rédaction. Le rapport porte aussi sur la longueur et le degré de difficulté du sujet, sa conformité à la définition de l’épreuve ainsi qu’aux programmes ou, le cas échéant, aux référentiels établis pour répondre aux spécificités des classes de troisième prépa-métiers, des classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l’enseignement agricole. La commission, au vu du rapport précédent, est chargée de la mise au point définitive et de la rédaction des propositions de sujets. Si les changements effectués par la commission le justifient, il est procédé à un nouvel essai.
Les propositions de sujets, corrigées si nécessaire et accompagnées d’un rapport des membres du corps d’inspection concerné, sont transmises au recteur de l’académie ou au vice-recteur ayant conçu le sujet. Il appartient au recteur d’académie, sur délégation du ministre chargé de l’éducation nationale et sur proposition de l’IGÉSR, de procéder au choix définitif des sujets au vu de ce rapport : les sujets, datés et signés par le recteur ou vice-recteur, sont alors transmis pour reprographie selon les consignes de la direction générale de l’enseignement scolaire.
Pour la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement scolaire,
Caroline Pascal
